Interminable. La route est longue, sans doute trop longue pour sauver la famille à l'arrière du pick-up. L’homme au volant fonce sans détour, entre la mine qui les a soufflés et l'hôpital de Mocha, le plus proche. Déjà trois heures qu’ils attendent de recevoir des soins.
Nous sommes au Yémen, et c’est une mine parmi tant d’autres qui les a blessés. Une mine abandonnée là par des militaires, et déclenchée par des civils.
« Ils en ont foutu littéralement partout, dans les champs, sur les routes. » raconte Agnès Varraine-Leca, qui s’est rendue trois fois au Yémen cette année pour Médecins Sans Frontières.
« Qui joue dans les champs évidemment ? Ce sont les gamins. Qui travaille la terre ? Ce sont les parents. Et en fait, ce sont des familles entières comme ça qui n’ont plus accès à leurs cultures, plus accès à leurs champs ou qui, littéralement, sautent sur des mines. Ça fait des générations entières d’estropiés. »
A la vue du drapeau aux couleurs de MSF, le conducteur accélère instinctivement. Le pick-up arrache le gravier du sol de la cour de l’hôpital. Ça grince. Ça hurle. Et puis la cloche tinte.
« A chaque fois que tu as une urgence, tu as cette cloche qui sonne et le son de la cloche à la fin, devient une angoisse. Une angoisse totale, parce que tu ne sais jamais ce qui arrive. » Les femmes et les hommes en blouse vert d’eau se ruent vers le pick-up.
A l’arrière du véhicule trône une imposante mitrailleuse, dont la taille et la puissance contrastent avec la carrure de celui qui la manipule. Le foulard qui habille sa tête est à moitié ensablé. Il semble hébété.
La poussière soulevée par l’arrivée tonitruante du pick-up n’est pas retombée que l’on décharge déjà quatre corps. D’abord, deux adultes. Sac mortuaire. Direction la morgue, il n’y a rien d’autre à faire.
« Les deux enfants qui ont entre cinq et dix ans, deux frères, eux sont vivants. » Le premier vit. Le second est pris de convulsions inquiétantes. « Il n’arrive pas à se maîtriser. En plus il est tout petit, dans une salle d’urgence qui paraît immense et il se secoue partout.
Il a un mini trou dans le crâne et ce mini trou qui me paraît rien du tout, c’est une entrée d’éclat d’obus. Ça fait un tout petit trou et dedans, ça fait un bordel énorme et c’est dans sa tête.
Donc le truc, tu peux te dire, c’est une écharde, en fait à l’intérieur, tu n’en as aucune idée et le fait est qu’à Mocha, on ne peut pas lui faire de scanner parce qu’on n’a pas ça. »
L’enfant doit être transporté vers l’hôpital d’Aden, le grand port du sud du Yémen, à six heures de route. Sa vie est de nouveau en jeu.
« On l’envoie là et puis on n’a aucune idée de ce qui va lui arriver. Et ce n’est pas un fait à part, c’est une réalité qui est quotidienne ».
A l’hôpital de Mocha, on vit avec la cloche, avec le manque de nouvelles, avec le vent qui fait vrombir les tentes du bloc opératoire, avec le bruit sourd des tirs d’artillerie.
Pour Agnès, le destin incertain de cette famille est devenu une histoire importante à raconter. Car le conflit au Yémen se joue à huis-clos.
Depuis 2015 le gouvernement yéménite, avec l’aide d’une coalition internationale menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, tente de repousser les rebelles houthis vers le nord du pays.
Une guerre de plus pour un pays dont les jeunes adultes n’auront connu la paix que par courts interludes.
La brutalité du conflit se cache derrière un contrôle sévère de l’information et une restriction d’accès et de mouvements pour les journalistes comme pour les acteurs humanitaires.
Les échos de la guerre qui parviennent en dehors du pays sont ainsi déformés et teintés de la propagande des belligérants.
En accueillant aussi bien les combattants que les civils, les hôpitaux deviennent des fenêtres sur les réalités du pays. Un pays où le prix des combats est souvent payé par ceux qui n’y prennent pas part.
Les roues touchent le tarmac de l’aéroport de Sanaa et c’est tout l’appareil qui s’ébranle vigoureusement. A l’intérieur, seize places seulement.
L’avion affrété par MSF est parti de Djibouti, à quelques centaines de kilomètres de la capitale yéménite, seul véritable point d’entrée dans le nord du pays.
Dans cet aéroport, pas de ballet d’aéronefs, aucune caravane de chariots porte-bagages, pas de foules impatientes d’arriver ou de partir.
« Simplement quand tu atterris sur cet aéroport, tu as des carcasses d’avions sur le côté : d’avions militaires, d’avions commerciaux » se remémore Agnès.
La fourmilière humaine et mécanique d’avant-guerre a cédé la place à un vaste espace désolé. « Il y a un comptoir avec un pauvre type tout au fond et des grands halls absolument vides et tout qui tombe un peu. C’est délabré, en fait.
Tu as le plafond qui se décolle. Enfin, rien ne va. Quand tu arrives là, tu sais qu’en fait, tu rentres dans un pays et qu’il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas. »
L’aéroport de Sanaa est à l’image du reste du territoire contrôlé par les Houthis : bombardé régulièrement depuis presque cinq ans par la coalition internationale.
Originaires de l’extrême nord-ouest du pays, marginalisés par le gouvernement, les Houthis prennent les armes et étendent les frontières de leur territoire vers le sud.
En septembre 2014, ils prennent la capitale, Sanaa, et tentent en mars 2015 de s’emparer du plus grand port du pays, Aden.
C’est là que l’Arabie saoudite, à la tête de la coalition internationale en guerre contre les Houthis, commence sa campagne de bombardements.
« Le premier soir, on a entendu les avions voler et… les bombes tomber. On s’est dit : “Il se passe vraiment quelque chose, ils lâchent d’énormes bombes”. Et quand la maison s’est mise à trembler, on s’est dit que c’était le début de quelque chose de très grave. »
Natalie Roberts, coordinatrice d’urgence pour MSF, arrive au Yémen au milieu de l’année 2015. « Quand on a entendu les bombes exploser autour de nous à Sanaa, on a commencé à se demander s’ils bombardaient vraiment des cibles militaires légitimes.
C'est une grande ville très peuplée, comment pouvaient-ils réussir à localiser précisément les cibles militaires ? Et plus nous remontions vers le nord, plus on s’est aperçu qu’il ne s’agissait pas de frappes de précisions.
Ou alors qu’ils ne s’y prenaient pas correctement, parce que plus on s’éloignait de Sanaa, plus on voyait l’impact des bombardements sur la population civile. »
Assise à l’avant d’un 4x4, Natalie remonte vers Saada, fief historique des Houthis et territoire déclaré hostile par la coalition, dès le début de la guerre.
Les habitants qui ne se sont pas enfuis sont désormais considérés comme des cibles légitimes. La population se retrouve alors prise au piège des bombardements.
La route est rocailleuse, les signes de vie sont rares. De temps à autre, elle s’étonne de voir des groupes de réfugiés érythréens ou éthiopiens marcher — peut-être sans le savoir — vers les zones les plus dangereuses de la région.
Plus le nord se rapproche, plus les stigmates des bombardements se font évidents. « Il y avait une succession de ponts sur la route.
Quand je suis arrivée, quelques mois après le début des bombardements, tous les ponts avaient disparu. Il y avait aussi beaucoup de camions bombardés…
Surtout des camions de nourriture. Je me souviens d’un en particulier, la première ou deuxième fois que je suis allée dans le nord. La plus grosse bombe était tombée sur des moutons.
Il y avait beaucoup d’animaux morts sur la route. Quand je suis passée, elle venait d’exploser parce que ça fumait encore… Les moutons brûlaient, c'était vraiment sinistre. »
Mariages, funérailles, écoles, marchés, stations essence… Rien ni personne n’est à l’abri des bombardements. Et les habitants finissent même par refuser de conduire les camions de nourriture, ciblés eux-aussi par les frappes aériennes.
Natalie entrevoit alors les risques qu’encourent les ambulances dans la région. « On ne peut pas quitter la route. On est à flanc de montagne, donc s'ils nous prennent pour cible, il n'y a pas d'échappatoire.
Tôt le matin, des équipes m'appelaient régulièrement pour me dire “On a un patient, il va mourir. On veut le transférer, mais des avions survolent la zone, qu'est-ce qu'on fait ?”
Et je n’avais jamais de solution. Il faut expliquer au patient et à sa famille que s'il reste là-bas, il va mourir. Et que s'il monte dans l’ambulance, il risque de mourir. »
S’il restait encore le moindre doute quant à l'intensité des bombardements, il se dissipe en un instant à l’arrivée dans la ville de Saada. De part et d’autre de grandes artères, les bâtiments se sont effondrés en domino.
« C’était impressionnant, la rapidité avec laquelle la ville a été détruite. Tout s’est produit en l’espace de deux mois. Les maisons et les magasins ont été détruits et de nombreuses rues sont en ruines. Ce qui fait assez peur…
A l'hôpital de Saada, où j’allais passer la nuit, tout le monde me répétait : “Ça va aller, parce que les hôpitaux sont toujours là”.»
Le volume de bombes larguées ici a quelque chose de symbolique, dans une ville qui l’est tout autant pour les rebelles. Ailleurs dans le pays, les dégâts sont plus épars.
Aden, le port le plus méridional, n’a pas autant souffert des bombardements aériens. Il a été rapidement repris par la coalition, repoussant les Houthis un peu plus au nord. Dès lors, une ligne de front s’établit autour de la troisième ville du pays, Ta’izz.
Centre intellectuel et industriel à l’époque, Ta’izz se retrouve assiégée par l’ensemble des belligérants. Voilà de longs mois qu’une partie de ses habitants est coupée du monde.
Les ravitaillements se font de nuit, pour échapper aux snipers. Et à pied bien entendu, par les versants de la montagne sur laquelle est perchée la ville.
C’est de cette manière que Thierry Durand, coordinateur d’urgence, s’y est lui aussi rendu au début de l'année 2016.
« Moi, j’ai commencé à m’y intéresser parce que les chirurgiens et les gens de la ville de Ta’izz qui sont arrivés à Aden, en passant à pied par la montagne, en pleurant, en me montrant des photos absolument dégueulasses de mecs éventrés avec les tripes à l’air, tu vois, à chialer.
Ils n’avaient plus rien, pas d’oxygène, pas de trucs comme ça, enfin tu ne peux rien faire. La plupart des hostos fermés ou incapables d’opérer. »
A 2 500 mètres d’altitude, Thierry cherche un peu sa respiration. Le convoi d’ânes, de chameaux et d’hommes atteint finalement une ville en proie aux bombardements nocturnes.
« On me dit au téléphone : “ll paraît que l’hôpital a été bombardé pendant la nuit”. Donc, je vais à l’hosto le lendemain matin.
Je vois le dirlo de l’hôpital et je dis : “il paraît que vous avez été bombardés cette nuit”. Et le mec éclate de rire. Il me dit : “Oui, oui, c’est la soixantième fois.” ».
La façade de l’hôpital de Ta’izz est criblée d’impacts de balles, de roquettes, de mortiers. « Donc, il me dit : “Mais on est habitués, on ne travaille plus dans aucun étage.
On travaille au sous-sol ou au rez-de-chaussée”.’ Ils avaient déjà réduit la capacité à une centaine de lits alors qu’ils en avaient six cents. »
Les hôpitaux sont une cible comme une autre au Yémen. Depuis le début du conflit, les structures de MSF ont été attaquées à six reprises. Et c’est bien sûr sans compter les dégâts infligés aux autres centres de santé préexistants.
« Bombarder un hôpital ne fait pas nécessairement beaucoup de victimes. Mais cela élimine toute possibilité de sauver des vies par la suite.
Le système de santé est l'un des fondements d’un tissu social. Alors si votre but est d’éliminer la population, vous vous attaquez à son système de santé. »
Au bas mot, la guerre aurait fait 91 000 morts et d’innombrables blessés. Parmi eux, les victimes des bombardements de la coalition internationale, mais aussi celles des mines posées par les Houthis le long des lignes de front, au sud-ouest du pays.
Accrochée à la côte, Hodeidah est le port stratégique de l’ouest du pays, sur la mer Rouge. La ville connaît à son tour l’irruption de troupes au sol et les intenses bombardements de la coalition, lors de l’offensive sur la ville en 2018.
« Ce qu’on a vu entre le début de l’année 2018 et juin, c’est que finalement sur toute la ligne de front du Sud qui passe légèrement au-dessus de Ta’izz et qui file un peu vers Mocha et remonte à Hodeidah. Sur cette ligne-là, il y a eu des avancées de la coalition.
Ils sont arrivés jusqu’à Hodeidah » rappelle Agnès, présente dans la région quelques mois plus tard. « Donc tu as cette offensive qui est lancée avec des troupes au sol, des bombardements massifs et c’est ce qui fait en fait qu’on ouvre à la fois Mocha en août et qu’on ouvre dans la foulée Hodeidah »
Deux nouveaux projets sont ouverts par MSF. Un premier dans la ville, au nord de la ligne de front. Et un second à Mocha, pour tous ceux qui se retrouvent coincés au sud des combats.
A 120 kilomètres plus au sud, le petit port de Mocha se retrouve fortuitement à un emplacement stratégique. A mi-chemin sur l’unique route qui relie Hodeidah et Aden.
Une route qui vient scinder une large bande désertique, le long de la mer Rouge. En guise de jalons, de minuscules villages, quelques carcasses de blindés, des bateaux échoués teintés de rouille. Et sinon, rien.
« Quand on dit qu’il n’y a rien, ce n’est pas une image, il n’y a vraiment rien. C’est une route et il n’y a rien d’autre en fait. Donc, tu te coupes un petit doigt, tu es hémophile, tu y restes aussi ! C’est vraiment… C’est un désert médical, littéralement. »
Alors à Mocha, un hôpital sous tentes est construit en quelques semaines, et rapidement les premiers patients affluent : femmes sur le point d’accoucher et blessés de guerre. Souvent victimes de mines, beaucoup arrivent en urgence, presque déjà trop tard.
« Les mines, c’est ce qu’on fait de plus cruel, de plus insensé. Les mines antipersonnelles, les jouets qui étaient balancés par les Soviétiques au moment de l’Afghanistan, c’est vraiment destiné, des jouets piégés pour que les gamins les ramassent.
Là, les mines, je ne sais pas si elles ont été mises intentionnellement pour la population, je n’en suis pas sûr, mais probablement pour empêcher que les troupes viennent.
Mais toutes ces mines enterrées, ça explose. Alors, les gamins sont très touchés, parce que les gamins, ça court partout. »
Dans son bloc opératoire, Bernard Leménager, chirurgien, voit surtout défiler des civils. « La guerre, ça touche tous les âges, ça touche tout le monde et ce n’était pas de 7 à 77 ans qu’on a eu.
C’était de 7 mois à 107 ans, peut-être pas 107 je crois que c’est 103. Mais c’était un centenaire ! Bon, le gamin de sept mois, il avait pris une balle dans le ventre qui lui avait perforé l’estomac.
C’était quand même un peu sévère et puis une balle de kalachnikov sur un bout de chou de sept mois, ça fait un gros truc... Ça s’est bien passé. Et le papy de 100 et quelques années, je dis quelques mais c’est sûr qu’il avait plus de 100 ans !
Il était né sous l’empire ottoman, ce gars-là. On n’en voit pas souvent des patients qui sont nés sous le sultan d’Istanbul !
Et donc ce papy-là, de 100 et quelques années, il avait des petits éclats d’obus qui n’avaient pas beaucoup de gravité, ce qui fait qu’en quelques jours, il a pu rentrer chez lui. »
De nombreux patients ont été frappés par des shrapnels, de petits éclats de bombes dont les dégâts sont toujours incertains. Il est parfois plus sûr de laisser les corps se réparer autour des fragments métalliques.
Pour ceux qui étaient trop près de la mine à son explosion, les conséquences sont souvent tragiques.
« Il y a beaucoup d’amputations. Alors c’est un problème pour le chirurgien qui doit décider de faire une amputation. Il faut savoir si le patient a une chance de guérir ou pas, de garder un truc fonctionnel.
Après, il faut convaincre le patient ou la famille et ça, c’est vachement difficile parce qu’en plus, on n’a pas la langue et qu’ils ont présent à l’esprit que, comme on est MSF avec tous les moyens qu’on leur apporte, on doit pouvoir éviter l’amputation. »
L’amputation s’impose comme la marque la plus ostensible que cette guerre fait porter aux civils. Mais l’impact des mines dépasse les blessures qu’elles infligent :
elles empêchent aussi les habitants de se déplacer librement, de cultiver leurs champs pour se nourrir.
C’est sur la route entre Mocha et Ta’izz que l’ampleur du problème se révèle pleinement. Le sentier y perce un paysage lunaire.
Sur les dunes trônent de petits arbustes dans lesquels viennent s’agripper de nombreux sacs en plastique. Le conducteur du tout-terrain dans lequel se trouve Agnès maintient son regard sur les bas-côtés.
Il prend soin de rester entre les petites pierres peintes en rouge, déposées de part et d’autres du tracé dégagé par les démineurs.
« Dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, c’est un problème et ça le sera toujours, parce qu’effectivement aujourd’hui, on a du déminage militaire,
donc on a des militaires qui sont spécialisés là-dedans et qui font ça, mais qui vont enlever les mines uniquement dans des zones qui les intéressent eux.
Ça veut dire les routes, principalement pour accéder, et puis ça s’arrête un peu là. Ce qu’on appelle le déminage civil, aujourd’hui, il n’y en a pas ou peu. Ça veut dire que les champs, personne ne s’en occupe.
Donc ça veut dire qu’en fait, la population civile, elle continue à sauter sur des mines et puis elle continue à ne pas cultiver ses champs parce que de toute façon, elle ne peut pas. »
Une bombe détruit un bâtiment, fait ses victimes. Mais une déflagration cache aussi des effets indirects et cumulatifs.
Détruire une route, un pont, un hôpital, c’est effilocher le tissu social et économique de toute une région. Les ressources se font rares ou moins facilement accessibles.
« Tu sors de Sanaa, et tu vois en fait ces longues files de voitures, mais à l’infini. » se souvient Agnès.
« Tu remontes ça pendant dix minutes en bagnole, des voitures qui attendent pour aller prendre de l’essence. Il y en a même qui attendent un jour, deux jours, trois jours pour charger leur voiture, avec des prix qui sont déments. »
Face aux maladies ou aux blessures de guerre, le calcul devient économique. « Les transports sont chers, donc ça veut dire qu’on reçoit finalement des gens qui arrivent en dernière minute, littéralement.
Parce qu’ils se sont dit : “Attends, le petit, il est malade, mais ça a l’air d’aller et puis, on n’a pas une thune, donc on va plutôt attendre”. »
Au Yémen, on meurt parfois d’avoir trop attendu. Ou d’avoir trop peu d’argent pour rallier l’hôpital. Une situation à laquelle Natalie a trop souvent été confrontée.
« Les blessés arrivent généralement rapidement. Certains sont déjà morts à leur arrivée et il n'y a rien à faire à cela. Leurs blessures étaient trop graves...
Mais pour beaucoup, il y a un autre problème : les difficultés de transport. Ils doivent alors attendre de réunir assez d'argent ou de trouver quelqu'un pour les amener jusqu’ici. Et donc les patients qui ne sont pas blessées ont tendance à arriver vraiment trop tard.
Nous avons vu tellement de jeunes enfants mourir de maladies contre lesquelles de simples antibiotiques auraient suffi.
Les nouveau-nés sont un problème particulier, parce que les mères qui ne parviennent pas à les nourrir attendent trop longtemps avant de les amener à l'hôpital.
Ceux-là mouraient généralement dans la première demi-heure car nous ne pouvions quasiment plus rien faire pour les sauver. »
Les équipes de MSF assistent à la résurgence de maladies pourtant disparues dans le pays, symptomatiques d’un système de santé à terre.
En 2016, une épidémie de choléra frappe le pays. La situation semble s’être stabilisée lorsque Ghassan Abou Chaar, responsable adjoint des urgences, arrive au Yémen, en 2017.
D’ailleurs, pour ses équipes, le choléra fait à peine partie des scénarios pour les mois à venir. Jusqu’à ce qu’un signal faible apparaisse...
« Et il y a un autre projet au nord à Khamer qui a reporté deux cas, possiblement de choléra. Le deuxième jour, ça monte à six. »
Dans l’hôpital de Khamer, les patients sont mis à l’écart. Le troisième jour, la salle d’isolement est pleine et une grande tente à proximité est réquisitionnée. Puis c’est une école toute entière qu’il faut investir pour accueillir les malades.
Progressivement, le nombre de patients pris en charge par les équipes de MSF finira par diminuer. De plus de 11 000 par semaine, au pic de l'épidémie, à 500 à la mi-octobre.
« Et là, on regarde les chiffres du pays qui sont reportés par l’OMS et qui continuent à augmenter. Dans les endroits où nous on travaille même !
Alors on a fini à un moment avec nos centres de traitement qui étaient à peu près vides alors qu’il y avait deux cents, trois cents cas reportés par l’OMS où on est, dans le même endroit, dans la même ville. »
Alors que Médecins Sans Frontières ferme ses centres de traitement, les comptes de l’Organisation Mondiale de la Santé — plus d’un million de patients — ne semblent pas coller à cette réalité.
« Tout le monde nous disait que tous les médecins, les infirmiers, les travailleurs sanitaires, ils ne veulent pas que le choléra s’arrête. Parce que si le choléra s’arrête, ils ne reçoivent plus leurs primes, alors plus de salaire du tout.
Alors, ils ont continué à reporter des cas. Chaque jour, le mec il se lève, il dit qu’il a reçu quinze cas, mais il n’y a personne pour contrôler. Il n’y a personne qui va voir est-ce que ces cas sont vrais ou non. C’est un système qui a continué à fonctionner. »
Dans ce contexte, difficile pour les ONG de suivre et de contrôler leurs programmes : avec des déplacements soumis au bon vouloir des autorités, et donc très limités, aucun acteur n’est en mesure de fournir des renseignements sur la situation humanitaire à l'échelle du pays.
En octobre 2018, les Nations Unies sonnent l’alerte : le Yémen serait en passe de connaître l’une des pires famines que le monde n’ait jamais connu à l’époque moderne.
Dans une interview donnée à la BBC, les images d’enfants émaciés précèdent une solennelle déclaration onusienne : « Nous prédisons que 12 à 13 millions de civils innocents pourraient être en danger de mort, par manque de nourriture. »
Et pourtant, cette réalité n’est pas perçue par les gens de terrain, comme Thierry. « En tout cas moi, je n’ai pas vu ni de degré très élevé de malnutrition.
Et certainement pas des éléments qui pourraient qualifier la situation de famine, certainement pas. Des vraies famines, j’en ai vu deux : au Sud-Soudan et en Somalie en 1992.
A chaque fois, c’est dû à la guerre, à des populations enclavées. Ce qui n’est pas le cas au Yémen. Au Yémen, tu peux circuler. »
Et bien qu’elle soit lourdement taxée par les autorités, revendue à prix d’or par les profiteurs de guerre, la nourriture continue malgré tout d’arriver dans les ports yéménites.
« On voit le Yémen de façon très parcellaire » reconnaît Agnès. « Aujourd’hui, on est la seule ONG autant déployée dans le pays avec une présence expatriée et nationale dans onze gouvernorats, donc c’est massif.
Pour autant, on est incapables d’avoir une analyse ou un aperçu global de la situation à l’échelle du pays. Tout simplement parce qu’on voit finalement le pays par des trous, qui sont extrêmement limités, qui sont nos hôpitaux. »
Faute de mieux, c’est donc à travers les centres médicaux que des fragments de réalité se révèlent petit à petit. Parfois de façon inquiétante. Et parfois, de façon plus optimiste.
« Nous avons eu une série de cas très bizarres de paludisme, puisque ces malades venaient des montagnes. Ce qui ne devrait pas exister car les moustiques ne volent pas si haut. »
Face à ces inexplicables patients, Natalie cherche à comprendre. Tous sont de jeunes adolescents venus du front, plus au nord.
« Il a fallu un certain temps pour que l’équipe me fasse suffisamment confiance pour me raconter la vérité. A savoir qu’il s’agissait d’adolescents recrutés ou engagés volontairement pour combattre avec les Houthis.
La ligne de front, la frontière avec l’Arabie Saoudite, était proche. Donc ces garçons ont été envoyés en première ligne. Et quand ils sont arrivés au front, ils ont compris leur erreur ou, pour certains d’entre eux, qu'ils n'avaient de toutes façons pas le choix.
Ils ont alors réalisé qu’il pouvaient se porter malades, et qu’ils seraient envoyés à l’hôpital. Alors le personnel leur a diagnostiqué un paludisme, et mis dans un lit pour la nuit. »
A l’aurore, les enfants soldats sont déjà partis. Au moins auront-ils une chance d’échapper aux combats et de ne pas revenir dans ce même lit d’hôpital, le corps troué d’une balle.
« Les médecins ont tous dit qu’ils ne savaient pas quoi faire d’autre, qu’ils ne voulaient pas les renvoyer au front. J’ai pensé que c'était l'une des meilleures choses qu'ils pouvaient faire, en réalité. Ils ont probablement sauvé des centaines d'adolescents comme ça. Oui, je peux dire que je n’avais jamais vu ça auparavant… »
« C’est un de ces conflits de confins, c’est-à-dire des périphéries contre le centre, des périphéries négligées ou abandonnées par le centre. Ce sont des zones inutiles pour le centre. Il n’y a pas de pétrole, il n’y a rien, pas d’intérêts. »
Depuis la réunification du pays en 1990, le Nord, c’est la région que l’on évite. Les services publics y sont malingres.
Les fonctionnaires mutés dans la région le vivent comme une punition. Trop de postes de médecins et de professeurs restent vacants.
De cette injustice naît une première rébellion entre 2004 et 2010, émaillée d’affrontements récurrents entre les Houthis et le pouvoir en place.
Dans le sillage de ces guerres et des printemps arabes, le conflit armé actuel se déclenche en 2015. Il s’intensifie et finit par tout déstabiliser, jusqu’aux fondements essentiels de la société yéménite.
« Pour moi, un des principaux problèmes qui est la cause de tous les autres problèmes, c’est l’absence de justice.
Comme il n’y a pas de justice qui est rendue en dehors de certaines formes de justice tribale, mais qui sont extrêmement compliquées et qui ne fonctionnent jamais en situation de guerre.
Ça demande des palabres longues et multiples au niveau de différents groupes tribaux pour régler des conflits, des fois pour un âne ou une vache ou un mariage annulé ou des choses comme ça.
Alors, pour la guerre, c’est beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué. » Face à la complexité de la justice traditionnelle et organisée, la simplicité de la justice populaire prend le relai.
Les armes sont partout, et l’insécurité rend certaines zones impraticables. Dans la ville portuaire d’Aden par exemple, Ghassan a remarqué la prévalence des armes à feu.
« Le souvenir d’Aden, c’est que si tu as 10 000 dollars tu peux avoir une petite milice avec un pick-up et quatre agents armés à l’arrière et tu peux les garder pour un mois et faire de l’argent à cause de ça.
En arrivant, c’était que ça : des pick-up avec des gens armés à l’arrière, qui se baladent dans la ville. Et ce qui est le plus drôle, que personne ne sait, ce groupe appartient à qui, on ne sait jamais.
Je crois que c’est pendant ma présence au Yémen, la ville s’est améliorée en termes de présence armée. Ça s’est organisé un peu plus mais c’est un bordel total, la ville. C’est une ville qui est en guerre civile pour moi. »
A Aden, toute forme de normalité s’est effritée. Au milieu du chaos politique, les criminels prospèrent et s’empressent de profiter des défaillances de l’état de droit. Ils ne sont pas apparus avec la guerre bien entendu, mais celle-ci crée un appel d’air.
« Il y a beaucoup de gangs criminels, il y a beaucoup d’activités criminelles. D’ailleurs même avant la guerre, la principale activité de notre hôpital était une activité sur les criminels ou les victimes des criminels
et on en a toujours aujourd’hui. Les autres hôpitaux n’en veulent pas. Ce sont des sacs de nœuds pas possibles.
Il y a des menaces, c’est-à-dire que les mecs de la famille ou les amis du criminel qui est hospitalisé veulent à tout prix le sortir ou le protéger parce qu’ils pensent que soit les flics ou l’armée vont venir, soit le tuer,
soit la famille des gens qu’il a tués va venir se venger à l’hôpital pour le tuer. Ça peut arriver, ce n’est pas passé loin plein de fois. »
Dans ces conditions, l’entrée de l’hôpital d’Aden est tenue par d’imposants gardes. Dans le vaste hall qui accueille les patients, tout le monde dépose son arme dans des coffres, plus ou moins grands.
Tout dépend s’il s’agit d’un pistolet, d’une Kalachnikov, ou d’un engin plus imposant encore. Une précaution élémentaire pour un hôpital qui s’élève en plein coeur d’Aden et qui prend en charge les blessés de tous bords :
civils, soldats de la coalition mais aussi sympathisants houthis ou encore membres d’Al-Qaeda. Le règlement de compte ou le dérapage n’est jamais très loin.
« Il y avait un mec qui voulait entrer voir son frère ou un truc comme ça. Et l’équipe lui dit : “Tu ne peux pas entrer maintenant, ce ne sont pas les heures de visite”.
Alors la personne a décidé de sortir une grenade de sa poche, l’ouvrir et a menacé les gardiens de la porte qu’il va faire exploser la porte.
Et un des gardiens, aussi normalement, il prend la grenade de la main de la personne, il la referme, il met le truc métallique dedans et il la garde.
Et là, on appelle les gens de la sécurité pour venir prendre le mec avec sa grenade. On en a eu plusieurs, pendant cette année, des problèmes. »
Dans une ville rongée par la criminalité et les attentats, l’hôpital ressent régulièrement les déflagrations environnantes. Bernard officiait en réanimation un jour, lorsqu’il a entendu un bruit sourd, suivi d’un léger tremblement.
« Les Yéménites qui étaient là, qui ont beaucoup plus l’habitude ont dit : “Tiens, c’est une bombe qui explose…” Et très vite, on a eu l’afflux massif de blessés.
On a eu, je ne sais plus, 100 qui sont arrivés, plus de 100 à 130 je crois, d’un coup avec je ne sais pas... Ça a dû faire une cinquantaine de morts. »
D’ordinaire, une cloche sonne lorsqu’un afflux massif de blessés s’annonce. Mais cette fois-ci, tout le monde est déjà prévenu et en chemin vers son poste.
Une procédure d’urgence qui s’impose aujourd’hui encore comme un rituel, dans une ville toujours prisonnière de la guerre.
La guerre qui ravage le Yémen depuis cinq ans ne semble pas avoir d’issue. Et la population yéménite n’a pas d’échappatoire.
« Même si vous n’êtes pas victime de bombardements, vous n’avez pas forcément les moyens d’acheter de la nourriture, de louer un logement.
Pour beaucoup, leur mariage sont en attente. Leurs familles sont en attente. Leurs vies sont en attente, d’une certaine manière. Et maintenant, quatre ans plus tard, ils ne peuvent plus aller de l’avant. »
A l’extrême-nord du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Arabie Saoudite, le village de Haydan se love dans les montagnes.
En plein territoire houthi, Haydan a souffert de multiples bombardements. Terrifiés, les habitants ont longtemps vécu dans des grottes, sans pour autant y être beaucoup plus en sécurité.
« Une grotte dans un village voisin a été bombardée et, d'après ce que j'ai compris, la bombe a explosé à l'entrée de la grotte.
La force de la bombe a en quelque sorte réverbéré et tué tous ceux qui s’y étaient réfugiés. Je n’ai jamais réussi à savoir combien de personnes étaient à l’intérieur.
Mais des voisins, vivant dans une maison à proximité, ont amené une petite fille. Ils disaient qu'elle était la seule survivante de sa famille. »
Sa blessure au front est légère, mais vers quelle vie retourne-t-elle ? Ses voisins racontent à Natalie les conditions de vie lugubres dans ces grottes.
« Vous ne pouvez rien faire. Il fait juste sombre. Vous dormez quand vous pouvez et puis vous essayez de sortir pour manger quelque chose chez vous. Les grottes sont humides, froides, et elles ne sont pas vraiment sûres en plus.
La famille qui a amené la petite fille disait : “On devrait rentrer dans nos maisons. Cela ne sert à rien de vivre dans des grottes. Autant vivre chez nous et advienne que pourra”. »
Le lendemain matin, la petite fille repart sans famille, avec des inconnus comme seuls compagnons.
« Je me demande combien de familles comme celle-là ont été détruites, ce qui se passe en coulisse. En arrivant dans une zone de conflit, tu prends conscience que la violence y est immense. Même la violence domestique augmente à cause de l’énorme pression qui pèse sur les familles, sur la société. Parmi les gens que l’on recevait à l’hôpital, je pense que beaucoup étaient des femmes et filles victimes d’abus, justement à cause de cette tension sociale.
Alors oui vous avez des patients, mais vous ne savez rien d’eux. On n’a pas le temps de simplement comprendre ce qui leur est arrivé. On se contente de réparer les dégâts physiques, puis de les renvoyer chez eux. Et c'est à peu près tout ce qu’on fait. »






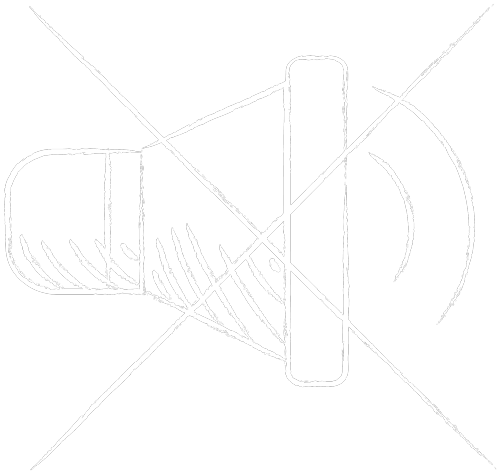









 Si vous préférez écouter le podcast seul, cliquez là
Si vous préférez écouter le podcast seul, cliquez là  Pour couper le son et continuer en lisant, cliquez ici
Pour couper le son et continuer en lisant, cliquez ici  Fermer et reprendre l'expérience
Fermer et reprendre l'expérience